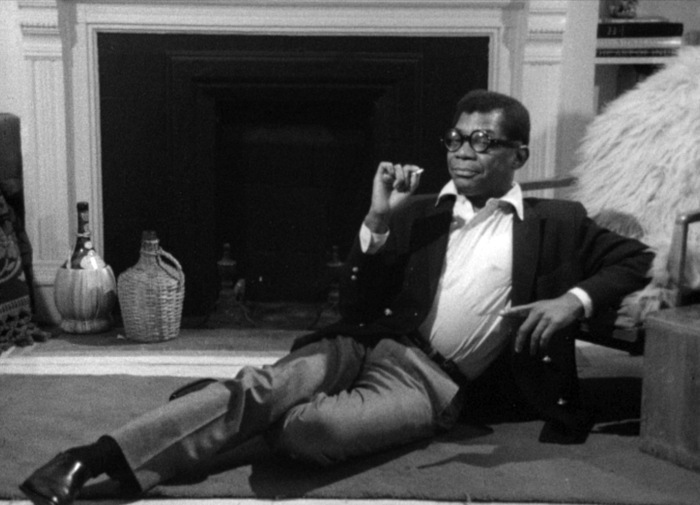Evénement annulé
Se promener aujourd’hui dans certains quartiers du Grand Paris peut relever d’une véritable expérience urbaine, comme le montre un rapide détour dans le centre-ville du Plessis-Robinson, les nouveaux quartiers de Puteaux, de Clamart, du Blanc-Mesnil ou encore à Val d’Europe. En effet, depuis les années 1990, un type d’architecture séduit un nombre croissant d’élus. Ce type d’architecture, issu de la promotion privée, est difficile à qualifier car elle ne relève pas d’un style unifié mais se caractérise par une addition d’emprunts à l’histoire de l’architecture. Le mot qui réunit ses différents styles est celui de « néo » : néo-haussmannien, néo-régionaliste, néo-art déco ou encore néo-traditionnel etc. Même si les « néo-styles » ne sont pas une nouveauté en architecture, leur succès et leur usage – plus seulement à l’échelle de l’édifice mais du quartier – peut interroger.
Notre propos n’est pas de porter un jugement de valeur sur cette architecture ni de prendre part aux débats théoriques et esthétiques. L’examen de ces environnements construits nous permet de questionner tout simplement notre perception commune de l’authenticité, de nous interroger sur la production des valeurs induites, les processus de leur lisibilité sociale et de leur réception, et les conditions de leur efficacité.
Il est aussi de parler de l’architecture de promoteurs, peu abordée et peu étudiée, alors qu’elle façonne une grande partie de nos villes et donc de nos imaginaires, personne ne pouvant fermer les yeux devant les édifices qui constituent le décor de nos vies, matérialisent notre rapport au monde et reflètent relations de pouvoir et vie collective.