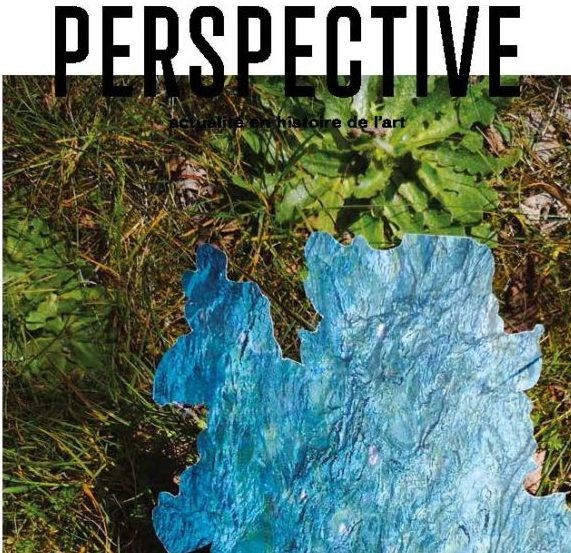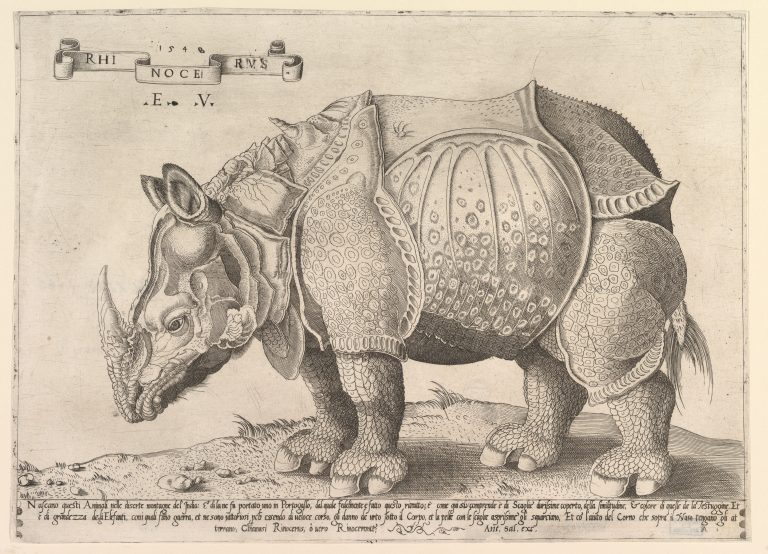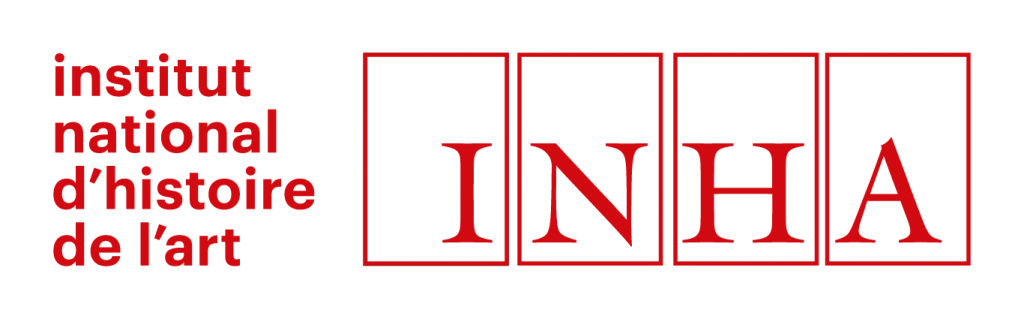Cet automne, la revue Perspective : actualité en histoire de l’art, éditée par l’INHA, consacre un numéro au Japon, invité d’honneur de la prochaine édition du Festival.
Au sommaire, de grands débats sur l’identité de la civilisation Jōmon, la transmission du patrimoine et les festivals d’art contemporain, des réflexions sur les mouvements contestataires dans le Japon d’après-guerre et sur la spéculation du marché de l’art de la fin des années 1980 ou encore des contributions d’artistes comme Hiroshi Sugimoto ou Takesada Matsutani. Comme un avant-goût du Festival, ce numéro offre un aperçu de la richesse de la création artistique et du patrimoine japonais. Des débats qui, pour certains, se poursuivront à Fontainebleau les 4, 5 et 6 juin 2021 autour d’invités prestigieux tels que le cinéaste Kiyoshi Kurosawa et l’architecte Tsuyoshi Tane.
Découvrez quelques extraits choisis du numéro…

Perspective : actualité en histoire de l’art
Japon n°2020 – 1
Édition : Institut national d’histoire de l’art
Revue semestrielle
396 pages | 182 illustrations couleur et noir & blanc
ISBN : 978-2-917902-89-9 | Prix : 25 €
> En savoir plus sur la revue Perspective
L’art japonais et moi, Hiroshi Sugimoto
Plus de la moitié de ma vie d’artiste contemporain s’est déroulée à l’étranger. On a beau parler aujourd’hui de monde globalisé, le travail d’un artiste est toujours considéré comme émanant d’une manière ou d’une autre de sa culture d’origine. Dans mon pays, je n’ai pas conscience d’être japonais, parce qu’il n’y a aucune nécessité à cela. Mais à l’étranger, je deviens un homme venu de cette lointaine contrée. À la fin de la période glaciaire, il y a environ 100 000 ans, le niveau des océans qui bordaient les terres japonaises s’est élevé, provoquant la formation d’îles séparées du continent, composant ainsi un territoire désormais aussi isolé que les Galápagos. Et moi, soldat solitaire de l’autre côté des mers, je me retrouve investi de la mission d’expliquer l’évolution et l’état actuel de l’Archipel, qu’il s’agisse de la conscience du vide, du sens de la couleur, de la vision de l’amour, du sentiment religieux, de l’hygiène des toilettes, ou de quoi que ce soit d’autre. Tel un acteur, j’endosse alors le rôle du Japonais, j’apprends mes répliques : je deviens « le Japonais » tel qu’on se l’imagine.
Chaque fois que j’expose à l’étranger, les journalistes me pressent de questions. À vrai dire, l’artiste lui-même ignore pourquoi il a réalisé une œuvre, c’est une sorte de révélation divine, on ne peut dire autrement. Pour ma part, c’est seulement une fois le projet achevé que je réfléchis à ce qui m’a poussé à l’entreprendre. Les œuvres les plus réussies sont celles qu’on peut expliquer de mille façons ; celles qui n’admettent que des explications limitées sont sans intérêt. Je prépare donc des réponses différentes pour chaque entretien, quitte à me contredire parfois. C’est aussi un moyen de me renouveler pour ne pas me lasser moi-même de ma vie d’artiste.
On me demande souvent, par exemple, à propos de ma série Theatres, pourquoi les écrans de cinéma sont blancs. Pour répondre, il me faut deviner assez rapidement le niveau de connaissance de mon interlocuteur : « Le blanc représente le huitième tableau des “Dix étapes du dressage du buffle” de la tradition zen, intitulé “l’homme et le buffle tous deux oubliés”. Sur le long chemin de la recherche de l’Éveil, on s’aperçoit un beau jour qu’on a complètement oublié sa propre existence ainsi que sa recherche. » Cette interprétation ne peut convenir que si la personne à qui je m’adresse possède quelques connaissances dans le domaine du zen. Je peux dire encore que ce blanc exprime le « retour aux choses mêmes » de la phénoménologie de Husserl, ou l’épochè, la « suspension du jugement », mais ce genre d’explication ne vaut que pour ceux qui s’intéressent à la philosophie du début du xxe siècle. Dans le domaine de l’histoire de l’art, pourquoi ne pas évoquer le Carré blanc sur fond blanc de Malevitch (1918, New York, Museum of Modern Art) ? Toujours est-il que je change de réponse comme de chemise. Mais si mon interlocuteur semble pris de court quoi que je dise, je passe aussitôt à un autre niveau : « Le film projeté sur l’écran est Blanche-Neige, le dessin animé de la première période de Walt Disney » Une jeune journaliste travaillant pour un magazine féminin est repartie satisfaite de cette réponse, avec de grands hochements de tête. Quel que soit l’interlocuteur, l’explication ne doit pas être indigeste pour lui. Et un estomac peut accueillir aussi bien la cuisine gastronomique kaiseki que les boulettes au poulpe des étals de quartier. La question n’est pas de considérer une interprétation comme supérieure à une autre. Tout commentaire est métaphorique, et consiste à tourner autour de l’œuvre tout en demeurant au dehors d’elle, car celle-ci, précisément parce que c’est de l’art, ne peut pas être explicitée. Il n’y a pas de réponse, a dit Marcel Duchamp, parce qu’il n’y a pas de question. Les mots, même les mieux formulés, destinés à définir une œuvre, ne seront jamais que des approximations. Une chose difficile à énoncer de but en blanc, voilà ce qu’est l’art. Il arrive que des critiques m’envoient leurs articles à l’avance, pour obtenir mon aval. Je leur réponds : « Vous pouvez déclarer ce que bon vous semble. Rien de ce que vous pourrez dire ne sera faux. » Un poème du moine zen Sōjun Ikkyū (1394-1481) dit en substance : « Je ne suis pas mort, je ne suis pas parti, je suis ici, mais ne me posez pas de questions, je ne parle pas. » Quand je réponds à des journalistes au Japon, je m’efforce toujours de garder ces mots à l’esprit. […]
Traduit du japonais par Corinne Atlan

Transmission du patrimoine architectural au Japon : décryptage, un débat entre Nishida Masatsugu, Yagasaki Zentarō, Yoshida Kōichi, mené par Jean-Sébastien Cluzel
Les questions relatives à la transmission du patrimoine architectural ont fait l’objet de nombreux débats dans les années 1990. Les voix de Françoise Choay (Paris, Seuil, 1992), Alain Schnapp (Paris, Carré, 1993), André Chastel (Paris, Liana Levi, 1994), Pierre Nora (Paris, Gallimard, 1994) ont particulièrement marqué ces échanges. Concentrés sur les civilisations européennes, voire méditerranéennes, tous se sont intéressés à la diversité des approches en matière de transmission patrimoniale et, en cherchant un envers aux pratiques occidentales, tous ont été interpelés par la pratique japonaise du shikinen-sengū au sanctuaire d’Ise, rituel dans lequel le sanctuaire est reconstruit à l’identique tous les vingt ans, avant que l’ancien ne soit démonté.
Cette pratique de reconstruction, attestée depuis le viie siècle et toujours en vigueur, permettait de remettre en cause, voire de critiquer sévèrement, une certaine hégémonie européenne en matière de conservation architecturale, que les filières patrimoniales et culturelles de l’ONU faisaient alors prévaloir. Dans ces débats engagés, le comparatisme fut une approche privilégiée, qui n’eut pas de pareil pour défaire l’idée d’un fondement universel des pratiques de transmission patrimoniales.
[…]
Jean-Sébastien Cluzel : Cette étiquette de la reconstruction systématique, qu’on la nomme zōtai ou « démantèlement », représente, pour les Occidentaux et depuis la fin du xixe siècle seulement, l’identité patrimoniale japonaise. Si une telle étiquette correspond à une certaine réalité, vous laissez entendre que l’image renvoyée est en quelque sorte pervertie par une vision matérialiste très éloignée de la culture japonaise, c’est-à-dire une vision occidentale. Peut-on dire que cette étiquette fut « acceptée » pour favoriser le dialogue avec l’Occident, mais que l’essence de l’architecture japonaise est ailleurs ?
[…]
Nishida Masatsugu : Pour ma part, il me semble que le Japon s’est longtemps laissé enfermer dans une discussion matérialiste, alors que, comme l’a laissé entendre le professeur Yoshida, l’essence de l’architecture japonaise est ailleurs, dans le provisoire, le temporaire, l’éphémère et même l’immatériel.
Ici, je ne veux pas dénoncer quelque méfait de l’occidentalisation de la culture japonaise. Au contraire, je pense que la confrontation des cultures japonaise et occidentale a facilité la révélation de l’essentialité de la première. En ce sens, l’ère Meiji a, me-semble-t-il, permis de mieux comprendre, voire même de découvrir la singularité culturelle du Japon. C’est à cette époque que l’architecture japonaise a été comparée à l’architecture occidentale, non seulement en confrontant des bâtiments, mais aussi les façons d’appréhender ces bâtiments.
Vous le savez, avant la réouverture du Japon, la langue japonaise ne disposait pas de terme équivalent à la notion occidentale d’architecture. La création de cet équivalent – avec toutes ses hésitations – eut lieu au début de l’ère Meiji. L’architecture fait appel à des concepts appartenant à la culture européenne, concepts qui explicitent les mœurs, « l’habiter », et le rapport créé entre les hommes et les bâtiments qu’ils édifient. Ainsi la traduction du terme architecture en japonais n’est pas une simple transposition, elle est une modification de la manière de regarder les édifices et de concevoir l’acte de bâtir. Et c’est bien ce processus de mutation qu’a choisi de suivre le Japon dans la deuxième moitié du xixe siècle. Aujourd’hui, le terme « architecture » est traduit par kenchiku 建築. Mais au début de l’ère Meiji – je parlais d’hésitations –, le ministère de l’Ingénierie du gouvernement Meiji, qui s’occupait de la construction des bâtiments publics et de la formation des futurs architectes japonais, avait d’abord opté pour le terme zōka 造家, qui possède une forte connotation technique et qui se constitue de deux caractères chinois : le premier zō/tsukuru 造 signifiant « fabriquer, construire, créer » ; le second ie 家 signifiant… « maison » ! Or il est évident que les Japonais du début de l’ère Meiji savaient que les Occidentaux ne bâtissaient pas que des maisons et ils savaient aussi que l’architecture occidentale ne traitait pas uniquement de construction. Cependant, c’est cet assemblage de caractères qu’ils ont choisi pour traduire le terme « architecture ». Ce choix initial est une piste pour recouvrer l’idée que se faisaient les Japonais de leur propre architecture au moment de la réouverture du pays : pour eux, la « maison », ie 家, représentait beaucoup plus qu’un bâtiment destiné à être habité ! D’ailleurs cette perception large de la maison perdure. De nos jours, les personnes âgées ou les habitants des villages de campagne utilisent encore le terme ie 家 pour désigner n’importe quel type de bâtiment. […]

Entretien avec Takesada Matsutani, par Valérie Douniaux
Takesada Matsutani est né en 1937 à Ōsaka, au Japon. Installé en France depuis 1966, il a mené une riche carrière internationale et a eu l’honneur en 2019, au Centre Pompidou, d’une exposition personnelle qui présentait notamment une donation de 22 œuvres au musée. Matsutani a également fait don à l’Institut national d’histoire de l’art, en 2020, d’un ensemble exceptionnel de 92 estampes et livres d’artiste offrant un panorama complet de son travail dans le domaine de l’image imprimée.
De 1963 à 1972, Matsutani a été membre du groupe d’avant-garde Gutai (littéralement « concret »), fondé en 1954 par Yoshihara Jirō (1905-1972). Gutai prônait une relation directe de l’artiste à la matière et, en véritable précurseur, concevait des installations et performances spectaculaires, menées dans des lieux inattendus. Matsutani a alors choisi comme outil de prédilection la colle à bois (colle vinylique), matériau moderne et bon marché, qu’il utilise encore aujourd’hui, faisant naître sur la toile ou le papier des volumes d’une grande sensualité. À partir du milieu des années 1970, les surfaces blanches et les volumes de colle sont recouverts de superpositions de traits de crayon graphite, d’un noir profond, aux reflets métalliques changeant selon les jeux de l’ombre et de la lumière. Les formats se font de plus en plus imposants au fil du temps, jusqu’aux installations spectaculaires présentées en 2017 à la Biennale de Venise (Stream Venice) et en 2019 au Centre Pompidou (Stream Pompidou). Si ces deux pans du travail de Matsutani, la créativité bouillonnante de Gutai et « l’œuvre au noir », sont bien connus du public et ont fait l’objet de nombreuses expositions et publications, les années consacrées par Matsutani à la gravure, en particulier entre 1967 et 1972, et la brève période, plus ou moins contemporaine, durant laquelle il a adopté une abstraction proche du Hard-Edge américain, ont été beaucoup moins explorées et exposées. Une exposition d’œuvres Hard-Edge, pour la plupart inédites, chez Hauser & Wirth à Zürich en 2016, suivie d’une présentation de gravures, de plaques et de carnets de l’artiste chez Hauser & Wirth Somerset en 2018, ont cependant permis de donner un coup de projecteur sur ces moments également importants du parcours de Matsutani, et l’exposition aux Abattoirs de Toulouse en 2020 1 d’une partie de la donation faite à l’INHA permettra de les mettre encore plus largement en avant.
Valérie Douniaux : Vous êtes arrivé en France en 1966, après plusieurs années de création intense au sein de Gutai. Vous n’aviez jamais quitté le Japon, le choc culturel a donc dû être assez important. Comment avez-vous vécu ces premiers mois loin de chez vous et ce bouleversement de votre environnement créatif ?
Takesada Matsutani : J’ai en effet ressenti un véritable choc culturel à mon arrivée en France. Tout me semblait différent du Japon. Ça m’a poussé à remettre en question ma place dans le monde, et mon mode d’expression. Aussi, quand un compatriote de ma classe de français m’a proposé de partir en voyage aux sources de la culture occidentale, de l’Égypte à l’Italie, j’ai immédiatement accepté. En plus, sur le plan pratique, je n’avais pas à Paris d’atelier me permettant d’utiliser la colle vinylique, je ne pouvais pas poursuivre la même ligne qu’au Japon. Je pense que je sentais aussi que j’étais arrivé au bout des possibilités de ce que je pouvais faire avec Gutai, je devais m’obliger à passer à autre chose. Je me suis souvenu des expositions de Stanley William Hayter (1901-1988) que j’avais pu voir au Japon et, en janvier 1967, j’ai décidé de pousser la porte de l’Atelier 17, présenté à Hayter par un compatriote, l’artiste Yayanagi Tsuyoshi (plus connu sous le nom de Yayanagi Go [1933-]). Hayter a accepté que j’intègre l’atelier et je me suis dès lors jeté dans l’apprentissage des techniques de la gravure.
Valérie Douniaux : Vous avez débuté la gravure une fois en France, mais vous y intéressiez-vous déjà au Japon ?
Takesada Matsutani : J’ai toujours souhaité faire de la gravure sur métal car, si le Japon a une grande tradition de gravure sur bois, les autres techniques y sont moins pratiquées. Il y avait probablement des ateliers, mais je ne les connaissais pas, et les artistes de Gutai ne pratiquaient pas la gravure. Donc, à part quelques linogravures à l’école quand j’étais adolescent ou quelques essais personnels de monotypes au rouleau, je n’avais pas eu l’opportunité d’expérimenter les divers procédés de gravure. J’avais pu voir des reproductions d’œuvres occidentales dans la revue Bijutsu Techō [Cahiers d’art]. Surtout, j’avais découvert le travail de Hayter à la Tōkyō Print Biennale, où il avait remporté le Grand Prix en 1960, puis à Ōsaka, où il avait été invité à exposer suite à l’obtention de ce prix. Le monde de la gravure était alors en effervescence, avec de nombreuses expositions internationales, d’importantes biennales, qui offraient aux artistes de belles opportunités d’exposer leurs œuvres à l’étranger… J’ai moi-même envoyé ma candidature à de nombreuses biennales lorsque j’ai commencé à travailler à l’Atelier 17, et j’ai ainsi eu la chance de pouvoir présenter régulièrement mon travail et même de remporter des prix. J’ai pu aussi envoyer mes gravures au Japon, où je continuais à participer à toutes les expositions Gutai, notamment lors de l’exposition universelle d’Ōsaka en 1970. […]
Tōkyō Underground – Le topos des avant-gardes japonaises au tournant des années 1960, Kei Osawa
[…]
Le vecteur du cinéma

On retient généralement de l’angura cette atmosphère vague et sulfureuse qui flotte dans les quartiers jeunes de Tōkyō à la fin des années 1960, perceptible dans la photographie et le cinéma de l’époque. Or son origine peut être précisément retracée. Le terme est employé pour la première fois de manière notable par le réalisateur, photographe et critique Kanesaka Kenji 金坂健二 (1934-1999) lorsqu’il organise, du 29 juin au 2 juillet 1966 au Sōgetsu Kaikan 草月会館12, sous le titre Underground Cinema, une série de projections de films expérimentaux en 8 et 16mm rapportés de son séjour aux États-Unis. Sont projetés des films d’Iimura Takahiko 飯村隆彦 (né en 1937), Stan Brakhage, Donald Richie, Joe Sedelmaier, Carl Linder, Robert Nelson et Kanesaka lui-même. Sur le programme figurent des textes de Jonas Mekas, de Robert Brown et du critique Tōno Yoshiaki 東野芳明 (1930-2005), exclusivement sur le cinéma. Kanesaka réitère sa présentation l’année suivante, du 8 au 14 mars, toujours au Sōgetsu Kaikan. L’Underground Film Festival présente alors les films de Jonas Mekas, Stan Vanderbeek, Bruce Baillie, Jud Yalkut, Kanesaka et Ōbayashi Nobuhiko 大林宣彦 (1938-2020). Les textes imprimés dans le programme (mis en page par Hosoya Gan 細谷巖 [né en 1935], comme pour l’édition précédente), signés par Stan Vanderbeek, Iimura Takahiko, Kanesaka Kenji et le réalisateur Hani Susumu 羽仁進 (né en 1928), traitent notamment de l’expanded cinema et de l’intermedia, toujours selon l’axe nippo-américain, mais en dépassant le paradigme strictement cinématographique pour s’ouvrir aux autres disciplines artistiques 13.
La diffusion du cinéma underground, sous influence américaine et par le biais de Kanesaka, est alors fulgurante. La revue spécialisée Eiga hyōron 映画評論 [Critique de cinéma] sous la houlette de l’éditeur et critique Satō Shigechika 佐藤重臣 (1932-1988) traite le sujet dans ses numéros de juillet et de septembre 1966, et le livre de Sheldon Renan, An Introduction to the American Underground Film, est traduit en japonais en 1969 14. Durant l’été 1968, la revue de cinéma Kinema Junpō キネマ旬報 [The Movie Times] publie en juin 15 puis en août 16 deux numéros spéciaux intégralement consacrés à l’angura. La situation a changé :- le cinéma n’est qu’un secteur parmi d’autres dans le vaste souterrain agitant la capitale. Ainsi le numéro de juin présente-t-il pêle-mêle les « chefs-d’œuvre de l’affiche psychédélique [de théâtre et de cinéma] », les troupes de théâtre underground, les « huit samouraïs de l’underground 17 », des photographies du théâtre et du cinéma underground, des manga, une table ronde sur les arts underground, un guide des lieux underground, et un article spécial sur le psychédélique et les drogues. Le numéro d’août poursuit cette ouverture vers les autres disciplines en accentuant le caractère érotique et contestataire de nombre d’œuvres présentées. Apparaissent ainsi le body painting, les happenings de Zero Jigen, un dialogue entre Yokoo Tadanori et l’acteur Takakura Ken 高倉健 (1931-2014), des articles sur la nudité, l’homosexualité, les drogues en lien avec l’underground, puis une section consacrée au cinéma underground, comme pour donner une cohérence, en fin de volume, à un numéro par ailleurs disparate.
La version numérique du numéro Japon sera accessible dans son intégralité aux lecteurs non abonnés
à compter du 1er janvier 2021.