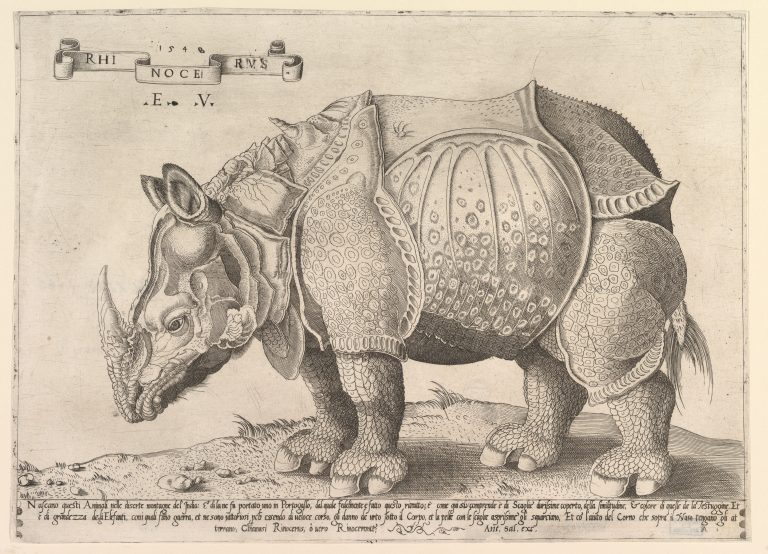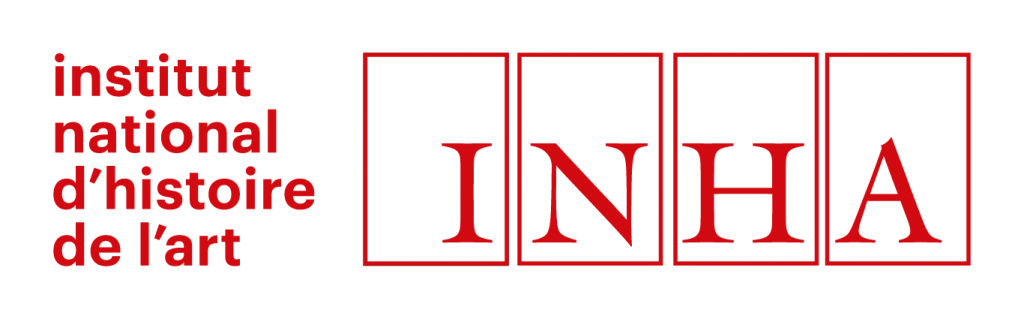Une carrière à contretemps
Manoel de Oliveira est né en 1908 au sein de la bourgeoisie industrielle de Porto. Comme il l’a déclaré à plusieurs reprises, et représenté dans son autoportrait filmique Porto de mon enfance (2001), il a éprouvé dès l’enfance une attirance vive pour le monde du spectacle puis pour le cinéma. Cette vocation l’a conduit à tourner à la fin des années 1920, de façon quasi artisanale, Douro faina fluvial, qui s’inscrit sur un mode mineur dans la lignée des symphonies urbaines caractéristiques du cinéma d’avant-garde de l’époque (on pense à Berlin, symphonie d’une grande ville ou àL’Homme à la caméra). À partir de cette entrée en matière, et pendant près de quarante ans, la carrière d’Oliveira va se trouver, de fait, contrariée. Dans un premier temps, sans doute un certain dilettantisme l’a-t-il fait hésiter entre une carrière d’acteur ou de coureur automobile avant de faire le choix définitif de devenir réalisateur de films ce qui le conduisit à signer son premier long métrage, Aniki-Bóbó, en 1942.

Ensuite des raisons économiques (la faiblesse de l’industrie du cinéma au Portugal), et surtout politiques (la censure sévère du régime de Salazar) expliquent que jusqu’à la fin des années 1960, Oliveira n’ait pu ajouter qu’un deuxième long métrage et une poignée de courts à sa filmographie. Pendant ses années de création contrainte, le cinéaste intermittent s’occupait surtout de la gestion de l’exploitation vinicole de sa belle-famille. Son œuvre put se déployer progressivement à partir des années 1970 accompagnant la fin de la dictature et les débuts de la démocratie après la Révolution des Œillets de 1974. Oliveira est alors reconnu dans son pays et, paradoxalement, surtout à l’étranger grâce à une série de films qu’il a baptisée lui-même « la tétralogie des amours frustrées » (Le Passé et le présent, Benilde ou la Vierge-Mère, Amour de perdition et Francisca, entre 1969 et 1981). Oliveira affirme alors un penchant pour une théâtralité raffinée (des plans longs, des interprètes hiératiques, des adresses fréquentes à la caméra), et une inclination pour l’enregistrement d’un texte littéraire qui en font un grand cinéaste de la parole. Ses deux films suivants, Le Soulier de satin, qui reprend la quasi-totalité de la pièce de Claudel, et Mon Cas, s’inscrivent dans cette même veine qui mêle goût du texte et artificialité de la représentation. À la fin des années 1980, Oliveira commence à s’écarter en partie du modèle de mise en scène élaboré précédemment, et propose des formes plus variées tout en diversifiant son registre, passant de l’épique à l’étude de mœurs, de l’introspection au fantastique. Cette fécondité paraît d’autant plus étonnante qu’elle s’accomplit à un rythme effréné chez un cinéaste déjà très âgé – il put ainsi ajouter quasiment un nouveau titre à son œuvre chaque année entre 1988 et 2012, à un âge auquel ses pairs ont généralement cessé leur activité. Dernière singularité de cette carrière accomplie selon un rythme inédit, à sa mort fut révélé son film posthume, La Visite, ou mémoire et confessions, réalisé en 1982 quand Oliveira dut vendre sa maison pour honorer des dettes. Cet essai personnel fut manifestement conçu comme une sorte de testament mais il apparaît rétrospectivement comme un point de recommencement de l’œuvre immense qui allait suivre.


Le cinéma comme art
La longévité fascinante du cinéaste et la dissymétrie de ses cycles d’activité rendent délicate toute tentative de synthèse qui risquerait d’affadir la richesse de l’œuvre, autant que de masquer les phénomènes de retard, de synchronisme, ou d’anticipation par rapport aux styles dominants des époques qu’elle a traversées. Depuis les prémices de son parcours alors que le cinéma est encore muet, jusqu’à sa mort en 2015, on peut toutefois relever au moins une constante : Oliveira n’a cessé de considérer le cinéma comme un art à part entière, ce qui impliquait à ses yeux une exigence formelle alliée à un regard acéré sur le monde et la société.
Son cinéma témoigne en effet d’une grande attention portée à l’image, notamment à sa composition souvent soulignée par une frontalité du cadrage et un goût pour la symétrie dans le plan. On est souvent frappé par une tendance au redoublement des motifs par des reflets ou des jeux de miroirs, ou encore par une façon peu conventionnelle de disposer ses interprètes en position d’adresse par rapport à la caméra, sans préoccupation pour la vraisemblance ordinaire. Moins qu’une pratique de la distanciation, il s’agit, dans bien des cas, de réfléchir au pouvoir de fascination de l’image et de susciter un réel enchantement esthétique, comme Val Abraham (1993) ou L’Étrange Affaire Angélica (2010) en témoignent de manière évidente.
Le sens visuel déployé par Oliveira ne doit pas faire oublier le rôle déterminant qu’il octroie dans sa mise en scène à la parole. Celle-ci peut venir directement d’un texte littéraire adapté, au registre d’ailleurs variable, être chantée (comme dans son singulier film opératique Les Cannibales, 1988), tendre vers une certaine sobriété ou au contraire flatter des formes de jeu expressives voire excessives. La présence aussi prégnante de la parole filmée participe en outre à la modulation continuelle du temps. Si les corps filmés tendent parfois vers un certain statisme, amplifié par les effets de composition mentionnés, la parole confère son rythme singulier au plan, en constituant dès lors sa dynamique secrète. Sans nul doute, Oliveira concevait-il le cinéma comme un art pleinement audio-visuel.

Une méditation sur l’Histoire
Dans la dernière période de sa carrière, émerge de manière évidente une riche et complexe réflexion sur l’Histoire de son pays. En ce domaine, NON ou la vaine gloire de commander (1990) reste une œuvre-phare qui inverse la légende héroïque pour insister sur les défaites du Portugal, depuis l’invasion romaine de la péninsule ibérique jusqu’aux guerres coloniales qui ont marqué la fin du régime de Salazar. Il s’agit de la sorte de montrer des échecs militaires ou politiques en révélant l’envers ironique de l’Histoire traditionnelle. Le film insiste sur la bataille (perdue) d’Alcácer-Quibir en 1578, où disparut le roi Dom Sébastien – événement clé puisqu’il scella la fin de l’expansion portugaise et mit le pays sous tutelle de la cour d’Espagne pendant plusieurs décennies. La mort du roi, dont la dépouille ne fut jamais retrouvée, a engendré le mythe d’un retour du « Roi Caché » venant instaurer un « Cinquième Empire », soit un empire catholique universel. Artisan de cette vision messianique de l’Histoire, le père jésuite António Vieira, qui vécut au XVIIe siècle entre le Portugal et le Brésil, est la figure centrale de Parole et utopie (2000), où il est représenté de façon émouvante, et en partie anachronique, comme un fervent opposant à l’esclavage. On peut citer également Le Cinquième, aujourd’hui comme hier (2005), qui reprenant une pièce de l’écrivain José Régio – écrivain d’ailleurs proche d’Oliveira – revient à nouveau sur la figure de Dom Sébastien en s’interrogeant sur le sens des événements historiques et la nécessité de l’idéal.
Deux autres titres concernent aussi cette méditation sur l’Histoire selon des modalités opposées. Réalisé juste après le 11 septembre 2001, Un film parlé (2003) suit une croisière de Lisbonne à Aden, en passant les grands ports méditerranéens (Marseille, Naples, Athènes…) et le canal de Suez, en s’attachant à une femme, professeure d’Histoire, et à sa petite fille. Le film se termine tragiquement par un attentat terroriste, le cinéaste sacrifiant ses deux héroïnes pour souligner l’angoisse d’un naufrage des valeurs européennes. Le constat désabusé semble alors proche de celui d’un Paul Valery au terme de la Grande Guerre. Pour sa part, Christophe Colomb, l’énigme (2008) porte un regard moins inquiet et plus enjoué sur la civilisation européenne. Son personnage est en effet persuadé que le grand navigateur génois était en fait portugais, et voue son existence à démontrer cette hypothèse, qui ne peut manquer d’apparaître comme un canular et vient rappeler l’ironie fréquente qui traverse l’œuvre d’Oliveira. Il faut bien insister sur le fait que le cinéaste n’a jamais craint d’apporter à ses films une touche d’impertinence pour empêcher la crispation des certitudes, le figement académique, ou même l’assurance du vieux sage qui viendrait délivrer la vérité sur l’état du monde.

Si Manoel de Oliveira a longtemps joui d’une réception ambivalente – la reconnaissance n’étant pas dénuée d’une certaine réserve, voire d’hostilité –, la ténacité du réalisateur poursuivant son œuvre en ayant allègrement dépassé un siècle d’existence, et une admiration internationale indéniable ont permis de confirmer son statut d’artiste majeur. La création récente de la Casa do Cinema Manoel de Oliveira, abritée à Porto, la ville où il passa toute sa vie, au sein de la prestigieuse fondation de Serralves en apporte la confirmation. Il est évident désormais que le réalisateur est considéré comme l’un des créateurs portugais les importants des XXe et XXIe siècles, à l’instar de Fernando Pessoa en littérature ou de Maria Helena Vieira da Silva en peinture.
Un texte de Mathias Lavin, professeur en Études cinématographiques, Université de Poitiers