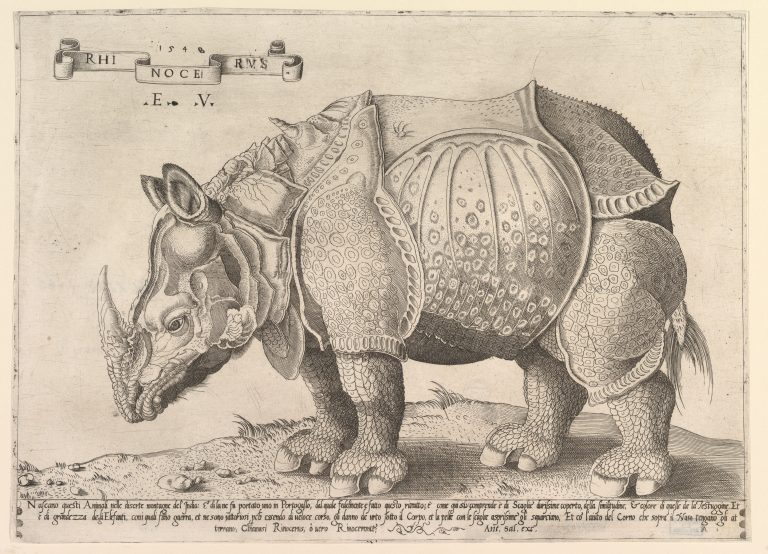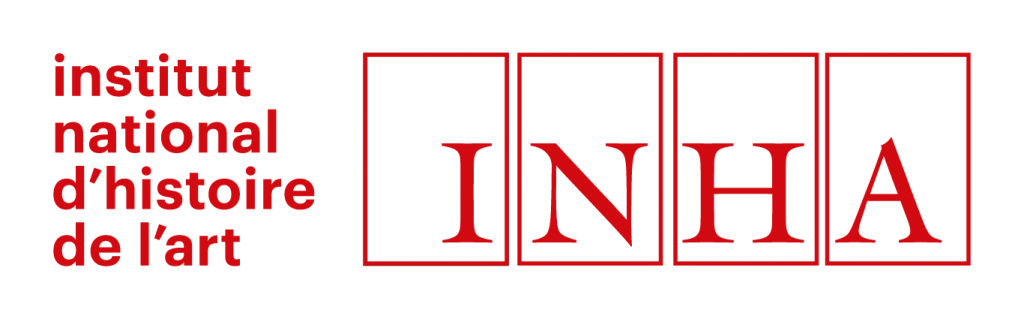Issue d’une lignée d’universitaires (sa grand-mère fut l’une des premières normaliennes), Jeanne Balibar suit d’abord un parcours classique d’excellence à la française : classes préparatoires littéraires, école Normale (en histoire)… mais, une fois arrivée, elle bifurque vers le jeu, va au Conservatoire, et quelques mois plus tard, à la Comédie-Française qui l’intègre comme pensionnaire (elle délaissera ensuite l’institution pour le cinéma). Ses premiers rôles à l’écran sont teintés d’une drôlerie légèrement menaçante. Ainsi de Comment je me suis disputé (ma vie sexuelle) d’Arnaud Desplechin (1996), où elle campe une Valérie insaisissable, un tantinet perverse, à la mécanique subtile, susceptible de varier du tout au tout, que contemple pétrifié d’incrédulité un Mathieu Amalric déjà bien perdu. Dès ce film générationnel, Jeanne Balibar déploie la caractéristique fondamentale de son jeu : une manière de s’imposer en déréglant le rythme habituel d’un dialogue, d’ondoyer face à ceux à qui lui font face, de troubler le naturalisme. Elle inscrit au cœur des scènes des trous d’air (« j’ai remarqué que si on laisse venir les trous, les suspens, si on attend sans peur, alors se produit l’inattendu de la vraie vie », explique-t-elle dans un entretien récent[1]), une bizarre « ligne de sorcière » (comme disait Gilles Deleuze de la pensée) qui, sans aller contre le film et les autres acteurs, impose des moments de suspensions, des surprises qui provoquent une attention plus soutenue du spectateur, attentif aux variations de vitesse de son jeu.
On se souvient de son apparition dans le Sagan de Diane Kurys (2008), où son personnage de Peggy Roche reste sur le fil, dans une drôle d’ivresse, à la fois soucieuse et flottante. Devant cette capacité à troubler les fictions, les cinéastes offrent souvent à Jeanne Balibar des rôles à double-fond, porteurs d’une inquiétante étrangeté. Dans la Comédie de l’innocence de Raoul Ruiz (2001), son personnage à la sombre douceur accapare les pensées de l’enfant d’une autre (Isabelle Huppert), menaçant de la remplacer comme mère. Dans L’Idiot de Pierre Léon (2009), adaptation d’une séquence célèbre du roman de Fiodor Dostoïevski, elle interprète Nastassia Philippovna, maîtresse du jeu social, qui fait tourner les têtes et sidère ses admirateurs en partant brusquement avec Rogogine (Vladimir Léon), son ultime coup de théâtre. Inquiétante et changeante, la figure qu’incarne Jeanne Balibar dans L’Idiot est moins manipulatrice que dépassée par quelque chose de trouble à l’intérieur d’elle-même, qui reste inexpliqué même pour son personnage. À l’étrangeté du jeu de l’actrice s’accorde une paradoxale sincérité, une franchise qui en fait souvent une héroïne candide, hors sol. On la retrouve égarée dans des intrigues labyrinthiques, comme son personnage amoureux du chant manipulée par une nuée d’espions dans Le Plaisir de chanter, comédie d’Ilan Duran Cohen (2007). Nombreux sont les films ou les pièces qui tentent de la perdre dans les méandres de leurs récits : au cinéma Jean-Claude Biette (Trois ponts sur la rivière, 1999, et Saltimbank, 2003), Jacques Rivette (Va savoir, 2001) ou Mathieu Amalric (Le Stade de Wimbledon, 2001, et le récent Barbara, 2017), au théâtre Olivier Py dans son adaptation intégrale du Soulier de satin de Paul Claudel (2003) ou, au sein des complexes enchevêtrements de textes et de références de ses spectacles, Frank Castorf, directeur de la Volksbühne de Berlin jusqu’en 2017. Un lieu où Jeanne Balibar a passé beaucoup de temps ces dernières années, y trouvant des rôles à la mesure de ses capacités impressionnantes à passer d’un registre à l’autre, du grotesque à la mélancolie, de la fureur à l’épuisement, du littéraire au littéral.
Au cinéma, c’est Mathieu Amalric qui aura poussé la comédienne vers la virtuosité de l’incarnation, en lui donnant le rôle-titre de Barbara (2017). Sur un scénario de Pierre Léon et Renaud Legrand, les premiers à avoir perçu la ressemblance d’esprit et de corps entre la célèbre chanteuse et Jeanne Balibar, Barbara met en abyme les jeux jouissifs et troubles de l’imitation. Le film mélange les vraies images et les reconstitutions, passe du play-back à l’interprétation live des chansons, expose le mythe pour mieux le déconstruire. Plus qu’une incarnation, Balibar effectue une véritable « interprétation » de Barbara, à tous les sens du terme : interprétation musicale et gestuelle, mais aussi manière de cerner, d’analyser le caractère et l’aura de la chanteuse, pour en jouer comme d’un instrument… Pour le film et l’actrice, l’interprétation prend la forme d’une intellection par le corps. Déjà en 1997, elle avait fait siens les mots d’Irène Papas : « On lui demandait : “Mais vous n’en avez pas marre de jouer depuis je ne sais pas combien d’années ?”. Et [Papas] répondait : “mais je ne joue pas, je pense…[2]” ».
Avec des études de danses jeune fille, et deux disques à son actif (Paramour, 2003 ; Slalom Dame, 2006) dont le cinéaste portugais Pedro Costa a longuement observé les répétitions dans son documentaire Ne change rien (2010), Jeanne Balibar sait ce qu’il en est, au-delà de la voix, de la musicalité d’un corps, d’une posture, d’une présence. C’est sans doute cette connaissance intime du jeu sous toutes ces formes qui l’a poussé vers la réalisation. Son premier film, coréalisé avec Pierre Léon, Par exemple, Électre (2015), s’ébauche autour des déboires d’un projet avorté de « Théâtre à emporter ». Sous une forme un peu expérimentale, cette satire du monde de la finance culturelle est une recherche d’un type singulier, à cheval entre théâtre et cinéma, où se déploient les différents rapports que peuvent tisser les corps face à un langage « trop grand pour eux » : qu’il soit celui d’une pièce de l’Antiquité (Électre de Sophocle) ou celui des novlangues néolibérales.
Quant à Merveilles à Montfermeil (2020), le premier film entièrement réalisé par Jeanne Balibar, il observe à partir du genre de la comédie loufoque, les multiples rapports que la politique entretient avec le corps social. En racontant les désirs et désordres d’une équipe municipale bien décidée à innover dans le registre des politiques publiques de gauche, Jeanne Balibar et ses complices (tous acteurs de talent : Ramzy Bedia, Emmanuelle Béart, Mathieu Amalric, Bulle Ogier, Marlène Saldana…) mettent en scène les potentialités de jeu du corps social, intégrant à leur groupe une centaine de non-professionnels de Montfermeil et des alentours, avec lesquels la comédienne travailla dans des ateliers montés avec la musicothérapeute Emmanuelle Parrenin et le chorégraphe Jérôme Bel. Manifeste politique pour le jeu et analyse du jeu politique, Merveilles à Montfermeil zigzague entre l’infini variété des corps, des langues, des identités, entre théâtre et cinéma, intimité et espace public, déguisement et convictions – des écarts qui résistent à toute tentative d’homogénéisation. L’énergie démesurée du film, qui tient autant à l’investissement complet des comédiens qu’à la liberté et la profusion des inventions fictionnelles, soutient une croyance militante : que le plaisir du jeu reste inséparable du sentiment collectif et du vivre ensemble.
Pierre Eugène, Université de Picardie Jules Verne
[1] « L’indéfinissable et la vraie vie » (entretien avec Ariane Chottin, Fabian Fajnwaks, Omaïra Meseguer), La Cause du désir, n° 104, 2020.
[2] Table ronde « Qu’est-ce qui fait courir les acteurs ? », Vacarme, n° 1, 1997.