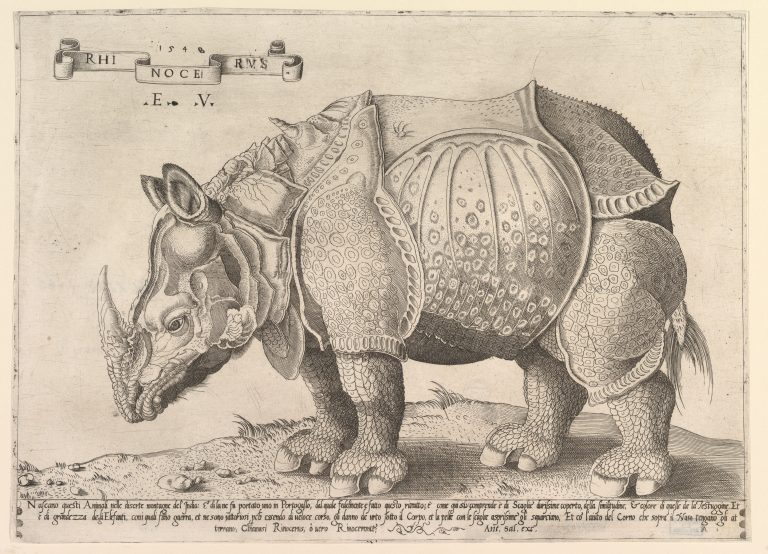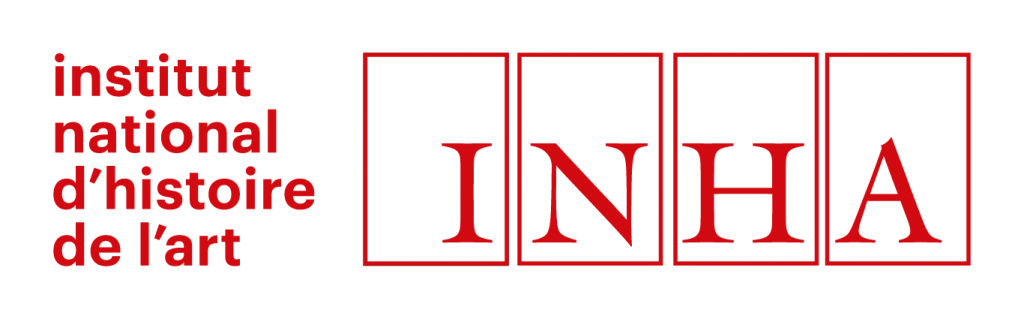Trois céramistes japonaises à Paris

Yoshimi Futamura, Chieko Katsumata et Setsuko Nagasawa sont céramistes. Elles ont quitté le Japon durant les années 1970 et 1980 et ont maintenant un atelier à Paris. Esthétiquement différentes, leurs œuvres s’inspirent pour certaines de l’art minimal, pour d’autres de couleurs et de formes du monde végétal, mais toutes reprennent le leitmotiv de la non-fonctionnalité qui s’apparentent davantage à la sculpture. Longtemps une affaire d’hommes, la céramique au Japon est désormais plébiscitée par les femmes. Yoshimi, Chieko et Setsuko sont d’ailleurs unanimes pour dire que cette discipline n’est pas davantage masculine que féminine. Si les convictions sont identiques les inspirations et les sensations divergent, elles, inexorablement.
L’équipe du Festival est allée à leur rencontre.
L’arrivée en France
Yoshimi Futamura nous fait signe depuis la porte de son atelier. Une fois appliquées les désinfections de rigueur, notre attention se porte instantanément au centre de la pièce où une agréable lumière caresse les contours des œuvres en cours de confection. Depuis près de 11 ans, Yoshimi travaille ici, dans le 19ème arrondissement. Avant elle disposait d’un autre lieu, aux Lilas. C’est le hasard qui l’a menée en France, elle qui rêvait avant tout d’Espagne. Mais dans les années 80 il fallait d’abord prendre l’avion jusqu’à Paris puis descendre dans les terres de Cervantès en train. Une facétie du destin et quelques décennies plus tard c’est à une céramiste à la réputation établie que nous avons le plaisir de parler, elle qui regrettait au départ que l’art de la vaisselle français était plus limité que celui de son pays natal.
La venue en France de Chieko Katsumata est plus évidente. Encore étudiante en architecture, elle décide de s’installer à Paris en 1973, cédant à l’appel de promesses d’un monde artistique moins corseté qu’au Japon et aux couleurs du monde occidental que la télévision lui projette depuis l’enfance. Une fois sur place, elle fait la rencontre de Fance Franck, une céramiste américaine chez qui elle effectuera son apprentissage. Dans le même temps Chieko s’inscrit à l’École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art. Paradoxalement pour elle qui ne concevait pas spécialement de devenir céramiste avant d’arriver en France, l’époque est ici à l’emballement pour le mouvement mingei qui a émergé quelques décennies plus tôt au Japon. Sous l’impulsion de Soetsu Yanagi, celui-ci prône une revalorisation de l’artisanat, en particulier céramique. Cinq ans plus tard, Chieko la tokyoïte décide de rentrer au Japon et de s’installer à Kyoto pour s’imprégner au mieux de la culture japonaise traditionnelle. Elle vit depuis entre Kyoto et Paris.
« La poterie est un travail d’homme »

C’est au sein de ce milieu et dans l’ancienne capitale impériale qu’a grandi quant à elle Setsuko Nagasawa. À 18 ans elle entre au département de céramique de l’Université municipale des Arts de Kyoto. Au début des années 60, il s’agit d’une école d’élite où la compétition sévère conduit à n’accepter que cinq élèves par an. Les examinateurs ne sont pas moins que Yuzo Kondo (dont le grand-père de Setsuko avait acheté des œuvres au début de la carrière) et le célèbre Kenkichi Tomimoto qui n’hésite pas à la rabrouer pendant son entretien : « Vous êtes si petite. La poterie est un travail physique. Il faut être solide et pouvoir s’habiller salement comme nous. »
Admise, Setsuko n’est alors que la troisième étudiante en céramique de toute l’histoire de l’école. De fait, l’époque était encore à la manipulation fréquente de matériaux particulièrement lourds et les femmes se font rares dans le milieu. Lorsque Setsuko supplie son père de la laisser passer l’examen d’entrée il lui rétorque : « Pourquoi ne pas pratiquer un art plus féminin, comme la teinture ? La poterie est un travail d’homme. » Dans le monde de la poterie japonaise traditionnelle, la coupe du bois et la cuisson au four impliquaient de ne pas dormir pendant deux jours. Souvent tributaires d’une importante force physique, beaucoup de domaines artisanaux étaient l’apanage des hommes. Si les femmes représentent désormais 90% des céramistes au Japon et la majorité des étudiantes de la discipline, la situation n’a commencé à réellement évoluer qu’au tournant des années 2000. Dans les années 70, était encore considéré comme une coutume le fait pour une céramiste de se consacrer exclusivement à son art sans fonder de famille, contribuant d’autant à la polarisation de la discipline.
« Quelque chose de plus que ce que je n’ai créé moi-même »

Pour Yoshimi dont les parents pratiquaient l’art du thé et qui a grandi dans les environs de Seto, célèbre centre de production aux environs de Nagoya, la céramique a toujours revêtu quelque chose de l’ordre de l’indicible et du secret. Petite, la manipulation des bols élégants dont se servaient ses parents lui était interdite de même que la boîte en bois délicatement ciselée dans lesquels ils étaient rangés. Contrainte d’aller les observer en cachette, elle a le souvenir particulier d’un petit bol noir cuit en raku. Des années plus tard, c’est la même adrénaline mêlée de surprise qui l’anime lorsqu’elle travaille. Car le four surprend. Toute experte que l’on est, nulle cuisson n’est sûre à 100%.
Une fois la porte refermée, on ne maîtrise plus totalement le destin de sa pièce. Le four fait parfois des cadeaux. Yoshimi dit que parfois le four donne vie à des choses « qui sont plus que ce que je n’ai créé moi-même ».

Cette question de la création, du style, de l’inspiration est centrale dans le travail de Chieko. A rebours d’une certaine inclinaison culturelle japonaise de tirer sa productivité de l’observation de la nature et du respect des saisons, Chieko a voulu au retour de son expérience parisienne marquer son originalité dès son installation à Kyoto. Elle conçoit alors les premières pièces d’une vaisselle marquant la coexistence de la vie japonaise et de la vie française. Une vaisselle qui va bien avec les baguettes et les couteaux-fourchettes, simultanément, loin des exigences traditionnelles japonaises pour lesquelles un même bol ne peut avoir plusieurs usages et où son choix est dicté par les saisons ainsi que le plat servi.
En 1996, Chieko superpose plusieurs petites pièces de vaisselle et donne naissance à ce qui deviendra une de ses séries emblématiques qu’elle appelle « sa citrouille » inspirée de formes végétales et florales. Séduite par l’impact de cette forme organique, elle en ressent la force de vie et l’appel de la nature, quelque chose de différent, de plus attractif à ses propres yeux que son ancienne pratique artistique. C’est à ce moment-là qu’elle commence à réfléchir sur la matière et la texture, elle s’interroge davantage sur le sens de la matérialité et de l’objet, de l’intérieur et de l’extérieur. Le plus important devient l’espace à l’intérieur de l’œuvre. Selon Chieko « la différence entre céramique et sculpture réside dans l’existence d’un espace immanent de néant. Cet espace vide se rapproche du mot japonais ma 間 qui signifie l’intervalle ou vide dans l’espace et le temps. Il s’agit d’un concept subtil qui, au-delà du simple espace physique, implique une expérience sensorielle du vide en tant que substance. J’ai découvert que j’étais inconsciemment axée sur ce point. La raison en est que mon travail actuel est une extension des vaisselles ».
Quinze ans plus tard, c’est une autre sorte de déclic qui assaille Yoshimi. Le façonnage de l’argile, le tour, la lente matérialisation de la forme a toujours été un combat entre elle et la matière. Mais là, cela ne fonctionne plus, beaucoup de ses pièces se brisent en sortie de cuisson. La catastrophe nucléaire de Fukushima est un choc, elle se dit que le Japon va peut-être disparaître. Depuis dix années, elle travaille désormais sur une nouvelle série caractérisée par l’aspect séché de la porcelaine blanche qui donne un aspect friable, organique à ses créations. Certains y voient du pain dans ce qu’il a de plus nourricier, d’autres la souche de l’arbre qui s’est éteint ou encore la terre fertilisée par la lave sur laquelle la végétation s’apprête à repousser.
Des années plus tôt, en 1977, Setsuko organise à l’École des arts décoratifs de Genève une première exposition qui va lancer sa carrière d’artiste. Elle qui avait déjà ouvert un atelier au Japon en 1967, s’était installée à Aix-en-Provence en 1974 et travaillé aux Etats-Unis, c’est forte de ses deux formations japonaises et américaines qu’elle donne libre cours à sa créativité pour concevoir de nombreuses pièces mêlant argile et magnétisme qui seront ensuite directement achetées par le musée de Genève. Critiquée par le milieu artistique local pour son avant-gardisme, un peintre suisse lui assène qu’une « femme ne devrait pas s’exprimer avec une telle intensité ! ».
Heureusement, quelque quarante-quatre années plus tard Setsuko n’a rien perdu de son expressivité et c’est avec plaisir que nous pourrons l’entendre en compagnie de Chieko et Yoshimi le vendredi 4 juin, de 14h00 à 15h30, au château de Fontainebleau, avec vous.