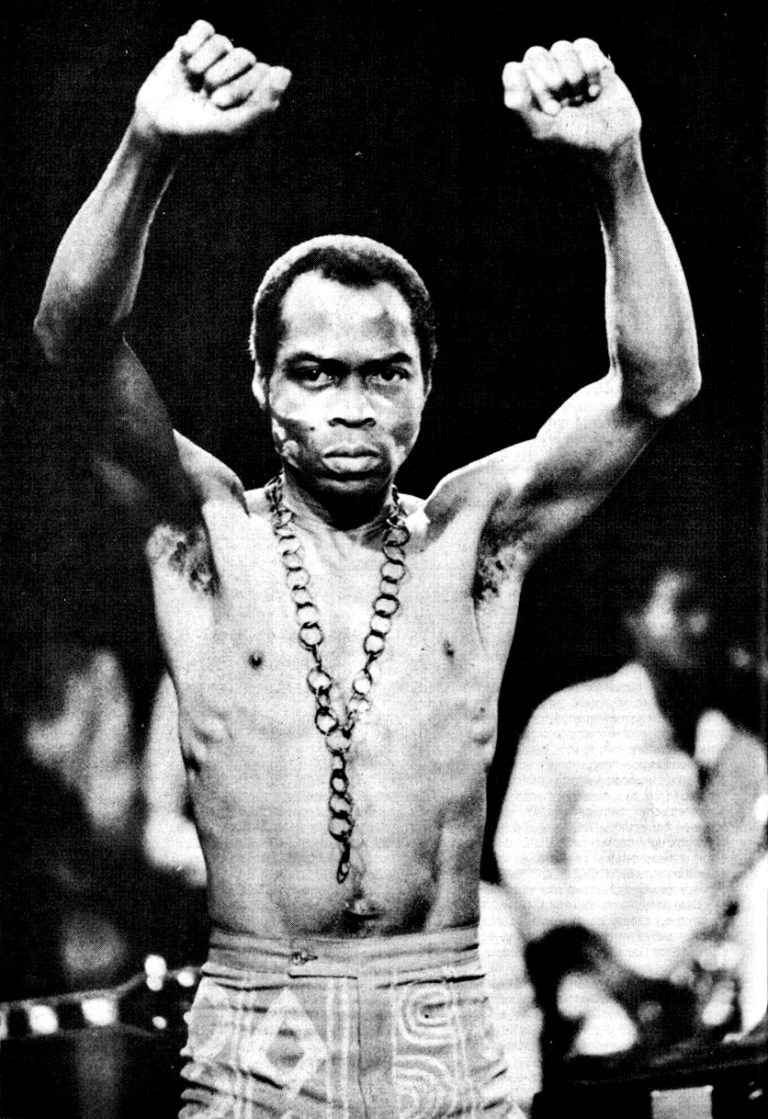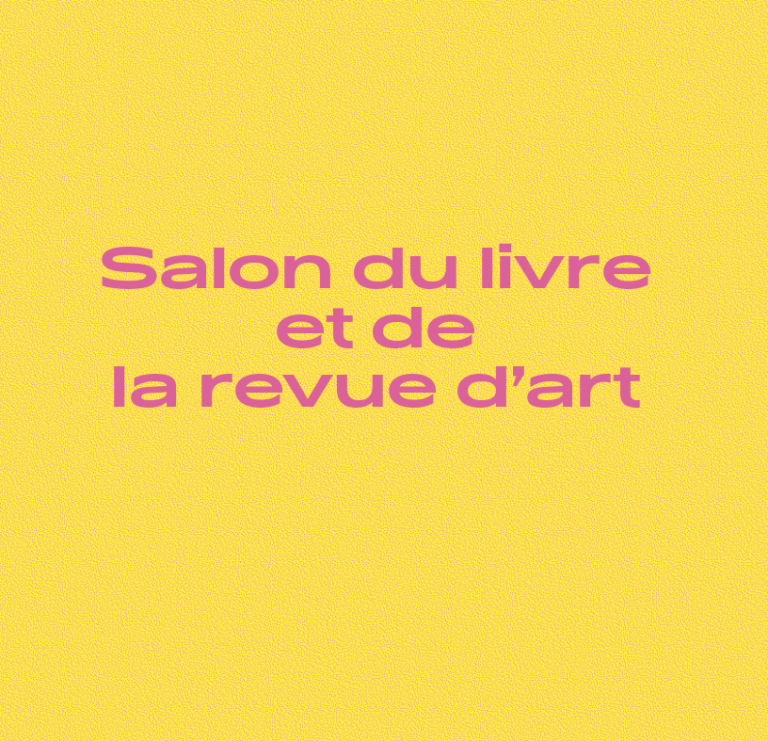Le 1er septembre dernier, Hadrien Laroche prenait ses fonctions de directeur scientifique du festival, succédant ainsi à Veerle Thielemans, directrice scientifique de 2019 à 2025.
[ENTRETIEN]
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Quel a été votre parcours avant d’arriver à la direction scientifique du festival ?
Hadrien Laroche : Né à Paris, écrivain, chercheur, docteur en philosophie, j’ai travaillé pendant vingt ans pour le ministère des Affaires étrangères, dans le domaine de la diplomatie culturelle, dans divers pays ; j’ai également été conseiller auprès de la commission française pour l’UNESCO pour les questions relatives à la protection de la diversité culturelle et du patrimoine culturel immatériel.
Je m’’intéresse particulièrement à la question des musées comme outil de diplomatie culturelle et la manière dont les institutions culturelles – l’INHA par exemple – façonnent l’engagement mondial : en particulier les enjeux des restitutions mais aussi l’intégration, le dialogue entre les cultures ou les questions sociales et climatiques.
Aujourd’hui, en parallèle de mon poste de directeur scientifique du festival, je donne un cours à Sciences-Po Paris sur la diplomatie culturelle et ces sujets, que j’ai intitulé « L’art de la relation ».
Mes recherches portent sur les questions postcoloniales, les traumatismes, la violence, la langue et l’exil, d’un point de vue philosophique, historique, esthétique et intime. Les objets y occupent une grande place.
La Restitution (2009), est la première fiction française qui a pour substrat historique la question des spoliations des biens des collectionneurs juifs pendant la Seconde guerre mondiale. Qu’il s’agisse des objets de la vie matérielle – l’imper d’occasion flambant neuf, le parapluie ou le piano volé dans La Restitution – ou des très nombreux objets de l’art présents dans mes pages, œuvres, objets volés, spoliés, de seconde main, objet de trafic, je les considère tous et toutes comme des vivants non-humains, avec leur propre agentivité, pour reprendre le terme de l’historien d’art et anthropologue Alfred Gell. Les objets de l’art sont parfois plus vivants que les vivants humains.
C’est aussi que j’ai en vue, à travers ce champ, et ce serait l’horizon inquiet de mon travail, la transformation de l’humain en chose : aliénation, exclusion, domestication, et, donc, par opposition, hospitalité, émancipation, joie. Mon ouvrage Duchamp Déchets, les hommes, les objets, la catastrophe (2014), en témoigne.

Que représente pour vous le festival et quelles orientations imaginez-vous pour les prochaines éditions ? En tant que directeur scientifique, comment souhaitez-vous voir évoluer cette grande manifestation ?
Hadrien Laroche : D’abord – et c’est ce que je voudrais avant tout souligner ici – c’est une grande joie d’être là, et je veux dire ici ma reconnaissance à celles et ceux qui m’ont confié cette nouvelle mission. Je vous le dis : c’est un rêve de retrouver la communauté des chercheurs et des chercheuses.
Je voudrais aussi saluer le travail de celle qui m’a précédé, Veerle Thielemans, qui a œuvré pour la consolidation et le développement du festival.
Ensuite, comme vous le savez, après ma mission de conseiller au cabinet de la ministre de la culture, Audrey Azoulay, chargé des idées et des relations avec les intellectuels, j’ai rejoint une première fois l’INHA, en tant que chargé du développement culturel et de l’international auprès du directeur, Éric de Chassey. Je connais donc le festival, j’y ai assisté, j’y suis intervenu en tant que chercheur.
Je considère le festival de l’histoire de l’art comme un idéal scientifique mais aussi éthique. Il est susceptible de transformer les apports de la discipline en interrogation esthétique, politique et citoyenne pour un large public.
Pour la communauté des historiens d’art et les professionnels des musées c’est une opportunité unique, le temps d’une villégiature à Fontainebleau, de s’immerger dans l’écosystème de la discipline : chercheurs, conservateurs, doctorants, étudiants, amateurs ; un lieu de dialogue, de rencontre des esthétiques, des imaginaires et des visions, de croisements des savoirs et des idées, un espace et un temps où trouver du nouveau.
Il s’agit, durant trois jours, autour du thème et du pays invité, de comprendre les œuvres, les images, toutes les images, toutes les œuvres, de toutes les époques, de montrer d’où elles proviennent et d’étudier leur contexte mais aussi leurs significations multiples et leur puissance.
La discipline de l’histoire de l’art est fondamentale pour combattre la cécité à l’égard de l’autre tant le rapport à l’œuvre est toujours un rapport à l’autre. Ou, pour le dire autrement : elle invite à voir, percevoir, sans capture ni compréhension nécessaire (le droit rappelé par Edouard Glissant à l’opacité), le visage de l’autre.
J’ajoute que je souhaite que les programmations culturelles et cinématographiques d’une part – celle-ci qui promet d’être passionnante tant la mode a inspiré les stars et tant le cinéma national marocain a une histoire aujourd’hui en plein renouveau – et le volet éducation et formation d’autre part, auquel je tiens particulièrement, soient mieux arrimés à la programmation scientifique du festival : unité de thème, de points de vue, d’enquête et ponts entre les conférences et toutes les manifestations artistique et pédagogiques proposées dans le cadre du château.
Pour le reste, j’ai l’intention tout d’abord de rencontrer cette communauté vivante et foisonnante de l’histoire de l’art – les chercheurs, les conservateurs, les artistes – et d’écouter/voir. Ensuite, avec la nouvelle directrice générale, Anne-Solène Rolland, qui a largement fait ses preuves en matière de gouvernance et de développement de la recherche, une formidable présidente du comité scientifique, Laurence Bertrand Dorléac, l’extrêmement talentueuse équipe du festival de l’histoire de l’art que j’ai trouvée en arrivant – Aniela Cornet, Sophie Goetzmann et Damien Truchot – et toutes les équipes de l’INHA et du château de Fontainebleau, sa présidente, Marie-Christine Labourdette et le délégué général du festival, Grégoire Bruno, les ministères de tutelle, nos partenaires, nous allons discuter ; le moment venu, nous pourrons faire de nouvelles propositions ou des recommandations. Je ne suis pas seul.

Le prochain festival s’intéressera à la mode et au Maroc, que vous inspirent ce thème et ce pays invité ?
Hadrien Laroche : Ah, le Maroc et la mode, outre que ces thèmes, ou ces termes, riment de belle manière, et en tous les cas allitèrent, la double thématique pourvu qu’on l’aborde avec l’œil impartial du chercheur, de l’artiste ou du poète (Baudelaire, à qui j’emprunte l’expression) peut ouvrir un champ de questions d’une très grande richesse.
On constate tout d’abord que cette paire thématique vient à un moment où, d’une part, la relation entre la France et le Maroc est en plein renouveau et où, d’autre part, les musées accueillent de grandes expositions ayant pour thématique la mode : de Louvre Couture qui tisse un dialogue, pour la première fois, entre les collections du musée et les réalisations de la mode contemporaine (et qui a franchi le million d’entrées), à Worth au Petit-Palais, de facture plus classique, ou bien encore Au fil de l’or : l’art de se vêtir de l’Orient au Soleil Levant, qui fait par ailleurs la part belle au caftan marocain, sous la forme des pièces présentes dans les collections du Quai Branly.
Or, outre que ces deux éléments ne sont pas de même nature, ici politico-diplomatique, là socio-culturelle, ils constituent deux écueils possibles dans l’approche de notre question : ici, se limiter à la relation bilatérale France-Maroc ; là, se limiter à l’illustration de l’art par la mode, ou inversement.
Aussi, et sans en dire davantage pour l’instant, nous pourrions essayer de proposer d’aborder le Maroc et la mode au prisme de l’histoire de l’art un peu à la manière de l’exposition sur la Mission Dakar-Djibouti au Musée du Quai Branly Jacques Chirac : par la contre-enquête. Ce que j’appellerai une contre-enquête visuelle.
De quoi s’agit-il ? Du réexamen d’une question qui implique un changement de point de vue ; de convoquer de nouveaux témoins pour se pencher sur les objets et leur contexte ; de croiser et décentrer le regard afin d’explorer les angles morts, de débusquer les biais ou les clichés de telle ou telle question.
En tant que directeur scientifique, c’est ce sens, ce regard, voire cette théorie critique, que je voudrais voir mis à l’œuvre par les chercheuses et les chercheurs, et tous les acteurs de la discipline, dans l’espace et le temps dévolus au festival de l’histoire de l’art à Fontainebleau.
Un regard porté par l’histoire de l’art qui ne néglige pas la société et ses contradictions. J’aime la définition de l’œuvre d’art proposée par le philosophe Théodor Adorno comme « expression de la souffrance et de la contradiction qui veut fixer une vie véritable sans pour autant la confondre avec la vie comme elle est ». Il faut avoir en vue le bonheur de l’individu.
S’agissant du Maroc donc – on s’intéressera à l’archéologie, mais dans la mesure où travailler sur les savoirs archéologiques contribue tant au renouvellement des études aréales sur le Maghreb, qu’à celui des études postcoloniales ; on s’intéressera bien sûr au Maroc de Matisse, Delacroix et d’autres, mais alors en réinterrogeant l’orientalisme ou ce qu’il en reste ; on s’intéressera aussi à la présence juive au Maroc – notamment à travers les collections de photographies du MAHJ – en se demandant si la photographie est ici le signe d’une image fatale de la disparition ; finalement il s’agirait d’interroger la façon dont à travers les lieux de l’art – musées, centre d’art, biennale – leur contribution à la production d’œuvres et l’accompagnement d’artistes présents sur la scène internationale, le pays a changé son regard et se projette d’abord aujourd’hui vers l’Afrique. Un Maroc africain.
S’agissant de la mode – on se souviendra d’abord que l’une des origines de l’INHA est le souhait du couturier, collectionneur et mécène Jacques Doucet, de créer une bibliothèque dévolue à l’histoire de l’art ; on s’intéressera bien sûr à la formation des styles, entre poncifs et émancipations, aux formes de conservation de la mode ; on s’intéressera aussi au vocabulaire de la mode, tel que la délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLLF) en a établi une première liste en 2023. Mais on pourrait aussi questionner, d’une part, la relation entre cette industrie, le marché et le musée – comme symptôme d’une possible marchandisation/accélération, perte d’aura de la culture et de l’art – la mode est une mine pour les musées – ou, inversement, le devenir mode de l’art, en tant que la mode serait le seul art à même de transformer nos vies et donc le monde.
Pour terminer, quel rôle l’art et l’histoire de l’art peuvent-il jouer dans les débats de notre époque ?
Hadrien Laroche : Tout d’abord dans ce contexte global de mise en péril de l’indépendance de la recherche, nous affirmons haut et fort à travers le festival : Stand up for science. Ensuite, le festival de l’histoire de l’art peut contribuer à nourrir les relations entre art, éducation et société, pour une démocratie meilleure et plus inclusive. Enfin, changer l’histoire : changer l’histoire et la société au prisme de l’histoire de l’art, voilà le cap.